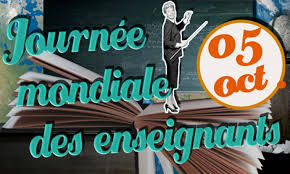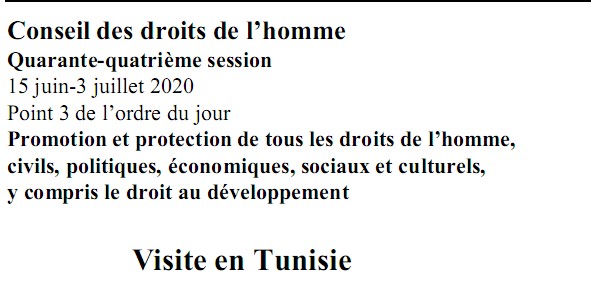Rien ne va plus entre les parents d’élèves et les écoles privées. Supportant des coûts supplémentaires (ordinateurs, tablettes, internet…) et obligés, pour la plupart, de jouer aux professeurs, les parents d’élèves des écoles privées ne veulent pas s’acquitter de la totalité des frais de scolarité du troisième trimestre, sur lequel s’étale la durée du confinement. Alors que la tension continue de monter entre les deux parties, le ministère de tutelle tente d’éteindre le feu. Quelle marge de manœuvre pour le département de l’Education nationale ? Où en est le dossier ? Déjà, beaucoup de parents d’élèves menacent de migrer massivement vers l’enseignement public. L’école publique a-t-elle les capacités? Les éclairages de Saaïd Amzazi.
Challenge : Quelle place le système éducatif national accorde-t-il à l’enseignement privé ?
Saaïd Amzazi : L’enseignement privé est une composante à part entière de notre système éducatif, tel que le stipulent la Charte Nationale de l’Education et de la Formation ainsi que la Vision Stratégique, deux textes fondateurs de ce système qui voient en lui un partenaire stratégique de l’enseignement public dans sa mission de service public, incarnée par une offre éducative équitable, diversifiée, de qualité, et qui préserve l’égalité des chances pour tous les marocains.
La loi cadre 51-17 de l’éducation n’a pas non plus manqué de reconnaître cette place de partenaire stratégique à l’enseignement privé, et précise en outre que ce secteur est lui aussi appelé à s’impliquer dans la lutte contre les disparités en matière d’éducation, notamment les disparités territoriales et sociales concernant les enfants des familles en situation d’indigence, mais aussi celles qui concernent les enfants en situation d’handicap ou à besoins spécifiques. Un autre apport important de cette loi cadre est qu’elle prévoit, dans son article 14, une refonte et une actualisation de la loi 06.00 qui régit l’enseignement privé en vue de pallier les dysfonctionnements constatés depuis des années.
Le Ministère s’est d’ailleurs déjà attelé à cette tâche, en coordination avec les représentants du secteur privé et ceux des fédérations de parents d’élèves, et travaille sur un projet de décret en ce sens permettant de mieux redéfinir les modalités de fixation des frais d’inscription, d’actualiser les frais d’assurance et mieux préciser les coûts des différentes prestations fournies par les établissements de l’enseignement privé.
Challenge : Que représente en chiffres le secteur de l’enseignement privé sur le terrain ?
L’enseignement privé primaire et secondaire abrite environ 14%, soit un peu plus de 1 million de nos effectifs d’élèves. Toutefois, la répartition des effectifs d’élèves inscrits dans des établissements privés montre une grande hétérogénéité, avec une concentration marquée dans 5 régions sur 12, lesquelles abritent plus de 78% de ces effectifs : Casablanca-Settat, Rabat- Salé-Kénitra, Fès-Meknès, Marrakech-Safi et Tanger-Tétouan. Cette forte disparité territoriale s’exprime non seulement entre régions, mais également au sein d’une même région. J’en veux pour exemple, le cas de Rabat qui abrite près de 45% des élèves du privé de sa région alors que Sidi Slimane n’en accueille que 8%.
En outre, l’enseignement privé au Maroc ne se résume pas simplement au nombre d’élèves qui y sont inscrits : c’est un secteur qui génère beaucoup d’emplois : 71.194 enseignants, 22.261 personnels administratifs et 42.467 emplois dans les services, ce qui représente tout de même environ 135.922 salariés qui travaillent dans ce secteur, et qui sont soumis au code du travail marocain.
Challenge : Comment expliquez-vous l’engouement des marocains pour les écoles privées ?
Je ne parlerais pas vraiment d’engouement…Rappelez-vous : en 2010, 12 % des élèves marocains étaient inscrits dans le secteur privé. Dix ans plus tard, le fait que ce taux atteigne 14% ne démontre pas forcément un engouement, mais plutôt ce que je qualifierais de simple préférence de certains marocains pour ce secteur.
Bon nombre de parents n’inscrivent pas leurs enfants dans le privé uniquement pour qu’ils aient un meilleur niveau scolaire, mais aussi, et surtout, pour l’environnement qu’ils y trouveront. Les établissements du secteur privé sont généralement sécurisés, offrent un encadrement important et des opportunités en matière de transport et de cantines et d’épanouissement à travers les activités périscolaires qu’ils proposent. Ils dispensent également plus d’enseignements en langues étrangères et proposent plus de flexibilité dans leurs horaires pour s’adapter à ceux des parents. Ces familles ont donc opté pour ce système et préfèrent voir leurs enfants évoluer dans un tel contexte. Ce qui a abouti d’ailleurs au triste phénomène de fermeture de nombreux établissements publics dans des quartiers favorisés des grandes villes où l’école publique ne parvenait plus à «trouver preneur»…
Challenge : Comment les écoles privées marocaines ont-elles assuré l’enseignement à distance au cours du confinement ?
Suite à la décision du ministère de suspendre les enseignements en présentiel le vendredi 13 Mars, il va de soi que le défi de l’enseignement à distance, unique moyen d’assurer une continuité pédagogique pour nos élèves, s’est très vite posé pour tous les établissements scolaires, publics ou privés. Grâce à sa plateforme « Telmidtice » et la création de classes virtuelles ainsi que la contribution des chaînes de télévision nationales, cette continuité pédagogique a pu être assurée aussi bien au profit des élèves du public que du privé. En ce qui concerne les établissements privés, les données émanant des directions régionales nous permettent d’estimer à environ 96% le taux d’écoles privées qui se sont engagées et impliquées afin de garantir cette continuité pédagogique à travers ces différents moyens cités ci-haut, ou d’autres mis en place par les établissements ou les enseignants.
Challenge : Quid du conflit qui oppose actuellement les parents d’élèves à ces écoles ?
En fait, tout ce conflit repose sur le paiement des frais de scolarités correspondant au trimestre qui a suivi la suspension des cours en présentiel. D’un côté, une très grande majorité de parents d’élèves ont refusé de s’acquitter de leur facture ou ont été dans l’incapacité de la régler et réclament une réduction sur ces frais, voire même, une exonération totale, notamment pour les parents d’élèves en arrêt de travail pour cause de crise sanitaire, ou ceux dont le salaire a été impacté dans ce contexte. D’autres parents estiment que les cours à distance dispensés ne justifient pas le paiement des frais de scolarité dans leur intégralité, puisque ceux-ci correspondent à un enseignement en présentiel. Sans compter que la nécessité pour leurs enfants de suivre les cours à distance leur a imposé des frais supplémentaires d’acquisition de matériel informatique et de connexion internet.
De l’autre côté, les établissements privés qui estiment avoir rempli leur part du contrat en assurant la continuité pédagogique et qui se déclarent également pénalisés par la crise du Covid-19, ce qui a d’ailleurs incité la ligue de l’enseignement privé à demander le soutien du Fonds spécial de gestion de la pandémie du coronavirus. Sans compter que, malgré les dispositions de la circulaire du ministère de l’Education nationale n° 80 du 24 juin 2003 qui invitent à renforcer la création des associations des parents d’élèves, 80 % de ces établissements ne disposent même pas d’association de parents d’élèves, qui constitue normalement leur véritable interlocuteur, ce qui a compliqué la gestion de ce conflit à l’échelle nationale.
Challenge : Comment le ministère peut-il intercéder au sein de ce conflit ?
La vraie question est plutôt de savoir quelle marge de manœuvre la loi marocaine accorde au ministère pour intercéder au sein de ce conflit… Dans son article 22, la loi 06.00 stipule que le ministère, à travers ses académies régionales de l’éducation, n’a d’autorité que sur l’autorisation de création des établissements privés ainsi que leur suivi et leur contrôle pédagogiques. Les rapports entre les familles et ces établissements, notamment en matière de frais de scolarité, ne sont pas de son ressort et sont régis par un contrat de droit commun. Il en va de même pour les employés de ces établissements qui sont soumis au code du travail national et ne peuvent donc être contrôlés que par les inspecteurs du travail.Sans cette assise légale et réglementaire qui lui permettrait de trancher dans ce débat interminable, le ministère ne peut donc que se contenter d’une médiation entre les deux parties dans un objectif de conciliation, ce qu’il a fait en menant des négociations à l’échelle centrale mais aussi au niveau des AREF ( Académie régionale de l’éducation et de la formation , NDLR) et des directions provinciales.
De nombreux établissements, qui sont à saluer, ont fait l’effort de réduire ou de reporter les échéances de paiement des frais de scolarités, voire même de les annuler, au regard du contexte difficile lié à la pandémie de Coronavirus. Mais pour une minorité d’entre eux, le blocage perdure, et je profite de cette interview pour, une fois de plus, faire appel à leur sens du patriotisme et de la solidarité humaine pour faire en sorte que cette situation conflictuelle, qui n’a que trop duré et qui nuit à l’image de l’enseignement privé aux yeux des marocains, se débloque et s’assainisse. En fait, la vraie marge de manœuvre qui revient au ministère aujourd’hui, qu’il compte exploiter au plus vite, lui est donnée, comme je le disais précédemment, par la loi cadre qui a permis de réellement baliser le terrain et nous donne autorité pour réviser la loi 06.00 de façon à ce qu’elle se conforme aux dispositions juridiques de la loi-cadre, qui stipulent que les frais d’inscription, des études, des services et d’assurance sont fixés par décret.
Nous avons donc entamé ce chantier de révision. Une proposition en ce sens sera prochainement soumise au parlement, ce qui constituera, vous en conviendrez, un acquis immense pour notre système d’éducation national, comme ce fut le cas d’ailleurs avec la loi-cadre adoptée l’été dernier. Compte tenu du fait que sur le terrain, l’offre du secteur de l’enseignement privé est très hétéroclite, aussi bien sur le plan des capacités d’accueil que sur le plan pédagogique ou sur celui des infrastructures et bien sûr des tarifs pratiqués, il nous faut, en premier lieu, élaborer un modèle de catégorisation des établissements privés sur la base de véritables indicateurs permettant une fixation objective des frais de scolarité, en fonction de la catégorie et des prestations réellement fournies par chaque établissement.
Par ailleurs, en vertu des articles 13 et 14 de la loi cadre 51-17, le nouveau texte réglementaire devra également se pencher sur la contribution du secteur privé de l’éducation au service public, et fixer un taux de participation des établissements privés en matière d’offre pédagogique gratuite au profit des enfants issus de familles défavorisées, ou en situation de handicap ou à besoins spécifiques. Des mesures incitatives diverses pourront être mises en place au profit des établissements privés pour leur permettre également de contribuer à l’effort de réalisation des objectifs de lutte contre l’analphabétisme et de l’éducation informelle.
Enfin, il ne faut pas perdre de vue que les établissements privés sont tenus, dans un délai de quatre ans, d’assurer leurs besoins permanents en cadres pédagogiques et administratifs, afin de se conformer à la loi cadre 51-17.
Challenge : Suite à ce bras de fer opposant les établissements privés aux familles, nombre de parents d’élèves menacent de migrer massivement vers l’enseignement public. Doit-on s’attendre à la rentrée prochaine à ce qu’un tel scénario puisse se réaliser ?
Déjà à la rentrée 2019-2020, donc bien avant cette crise, 52.000 élèves ont quitté les établissements privés pour s’inscrire dans le système public. Il faut toutefois mesurer les conséquences de ce transfert massif d’effectifs vers le système public à la lumière de la réalité du terrain. Tout d’abord, il est absolument incontestable que l’éducation est un droit consacré par notre Constitution, et que l’Etat marocain est tenu d’assurer à chaque enfant sa place dans un établissement scolaire public. Donc, tout enfant quittant le système privé pour le système public lors de la prochaine rentrée devra trouver sa place dans un de nos établissements publics.
Toutefois, les réformes récentes entreprises par le ministère pour améliorer le système scolaire public, commencent à porter leurs fruits, tel que le démontre la réduction de la massification au sein des classes, qui a nécessité des années d’efforts en matière de réhabilitation et de construction de nombreuses écoles, collèges et lycées, ainsi que de recrutement d’enseignants. Notre objectif était de limiter l’effectif des classes à 30 élèves pour la première et deuxième année du primaire et 36 pour les autres années. Grâce à ces efforts, le nombre de classes du primaire qui dépassent un effectif de 45 élèves ne va pas au-delà de 5% actuellement. C’est une avancée majeure. Mais aujourd’hui, ce risque d’exode massif de nos élèves vers le système public, qui est un droit acquis, je tiens à le préciser, risque de compromettre tous les efforts accomplis : nombre de nos établissements scolaires publics verront leurs capacités d’accueil dépassées et renoueront avec le phénomène de massification au sein des classes, ce qui affectera considérablement la qualité des apprentissages scolaires. Et vous en conviendrez, ce n’est pas du tout dans l’intérêt des élèves…
Sans compter que même si nous envisageons le scénario le moins lourd, à savoir la migration de 20% seulement des effectifs du privé, cela représente tout de même plus de 200.000 élèves à accueillir, ce qui nécessiterait l’ouverture d’ici deux mois pour la rentrée scolaire, de plus de 400 établissements, sur la base de 500 élèves par établissement. Autant dire que nous parlons d’une mission impossible.
Challenge : Votre dernier mot ?
Il va de soi que la crise du Coronavirus a eu le mérite de révéler au grand jour les limites de l’organisation et de fragilité de la gouvernance de nos établissements privés et constitue l’élément déclencheur de profonds changements au cœur de notre système éducatif. La révision très prochaine de la loi qui régit ce secteur, apportera des améliorations notables, c’est incontestable, notamment pour recadrer les rapports établissements – familles. Le secteur de l’enseignement privé est érigé par la loi en tant que véritable partenaire du secteur public, et accueille plus d’un million de nos élèves. Il mérite à ce titre toute notre attention, nos efforts et notre soutien. Il est donc de notre devoir de l’accompagner dans sa restructuration et de le sauvegarder.