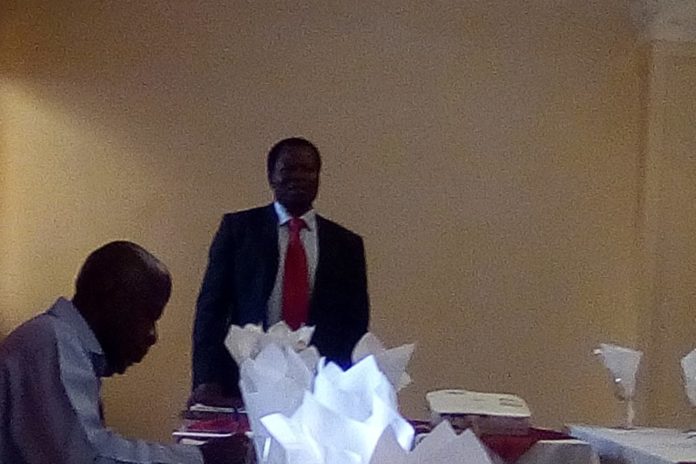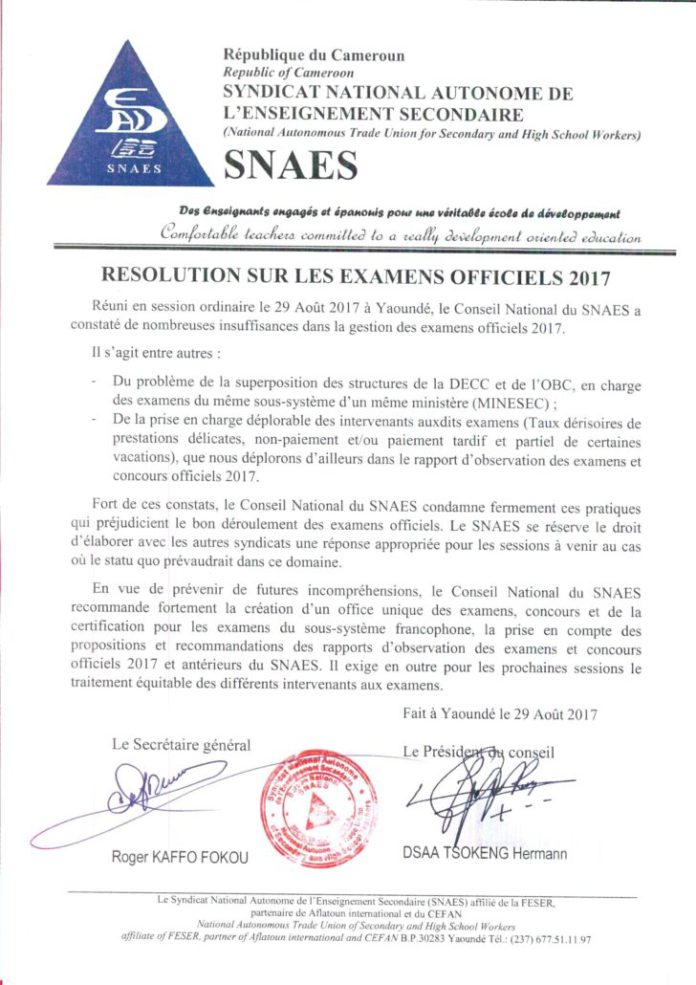Par Roger KAFFO FOKOU, SG/SNAES et Membre CA/CEFAN, Porte-parole des syndicats dans les discussions avec le Gouvernement.
Le sujet, tel qu’il nous a été proposé, était revêtu d’une neutralité si rassurante qu’elle en masquait les principaux enjeux :
Relever le défi de l’ODD4 au Cameroun : la contribution des syndicats comme organisations de la société civile.
Très peu de choses autour de nous nous montrent que l’on s’attèle à relever le défi de l’ODD4. On en parle pourtant à tout bout de champ. C’est un peu comme un cultivateur de haricots qui n’arrête pas de parler de la récolte des arachides. Comment contribuer concrètement à quelque chose de virtuel ? Il nous semble qu’il faut d’abord pousser les acteurs à quitter le virtuel pour le réel, à nous y rejoindre. L’ODD4 est avant tout un défi, un énorme défi : en quoi et pour qui ? Il faut le savoir. On ne peut relever un défi en agissant comme d’ordinaire, en ronronnant comme d’habitude, en usant de ressources ordinaires, en diminuant même les ressources ordinaires et en augmentant les enchères verbales. Qu’est-ce qui a changé dans les modes d’action et les ressources mises à contribution par l’État camerounais pour que l’on puisse parler d’une volonté quelconque de relever un quelconque défi ? Il faut aussi évacuer ce préalable. Les syndicats d’enseignants camerounais : quels sont leur statut et leur position sur le champ stratégique de la mise en œuvre de l’ODD4 ? Ceux-ci leur permettent-ils d’y contribuer de façon substantielle si ce n’est décisive, et quelle a jusqu’ici été leur contribution ? Voilà les fils d’Ariane qui vont guider notre tentative de nous en sortir dans le véritable labyrinthe dans lequel ce sujet nous jette.
I. Pourquoi et pour qui l’ODD4 représente-t-il un défi ?
I.1. Pourquoi ?
I.1.1. Sa formulation : mise en exergue de l’inséparable association de la qualité et de la qualité
L’ODD4 est formulé ainsi qu’il suit :
« Assurer une éducation inclusive et équitable de qualité, et promouvoir un apprentissage tout au long de la vie pour tous. »
Cette formulation est remarquablement équilibrée, comme le serait celle d’un vers classique divisé en deux hémistiches, chacun des hémistiches mettant en exergue l’un des deux éléments qui font de l’ODD4 un véritable défi : « qualité » au premier hémistiche, « pour tous » autant dire quantité au deuxième hémistiche.
La qualité fait partie de ces concepts que le langage ordinaire d’abord, puis progressivement le langage soutenu ont dévoyés de leur véritable signification. La qualité est la propriété d’une chose, d’un être, à être ce qu’elle/il est ou doit être. Parler de qualité, c’est implicitement parler de « bonne qualité », et parler explicitement de « bonne qualité », c’est user de redondance. Aussi l’ODD4 s’y est-il refusé. Parler de « mauvaise qualité », c’est nier la qualité, absolument ou relativement ; c’est affirmer le défaut, la défectuosité, l’insuffisance, le vice. Quand une éducation cesse d’être de qualité, elle devient défectueuse, vicieuse, absolument ou relativement. Et au lieu de former, elle déforme ; et au lieu d’enseigner la vertu, elle enseigne le vice : tricherie, paresse, corruption, esprit de facilité, culte du moindre effort, goût pour le rêve, développement de l’égoïsme, effacement du sens du sacrifice… Prendre parti pour ou contre – la position neutre dans ce cas est sans doute pire que la position contre – la qualité de l’éducation, c’est prendre parti pour une bonne éducation ou pour une éducation défectueuse, vicieuse.
La quantité quant à elle est une grandeur relative qui en appelle toujours à la mesure, et exige une unité de mesure. La quantité peut être infinie ou infinitésimale. Il faut donc toujours préciser la quantité pour qu’elle devienne réalité. Aussi, dans sa formulation, l’ODD4 précise-t-elle la quantité de manière emphatique : « pour tous » et « tout au long de la vie ». L’ODD4 donne-t-il une quelconque latitude de choisir entre la qualité et la quantité ? Le choix de « et » répond clairement par la négative à cette question. Ce n’est pas l’une ou l’autre, c’est l’une « et » l’autre. Et cela se comprend parce que la quantité est une des conditions essentielles de la qualité. Comme dans le domaine de la santé – l’éducation n’assure-t-elle pas la santé intellectuelle et spirituelle ? – la posologie, si elle n’est respectée, la médication n’est point de qualité. Si au lieu de 35 à 45 élèves vous en mettez 80 à 200 dans la même classe, cette quantité en évacue la qualité de l’enseignement reçu automatiquement. Si vous mettez un enseignant d’EPS pour 900 élèves comme c’est le cas aujourd’hui, la qualité de cette éducation disparaît aussitôt. Quelles conséquences peut-on tirer de ce lien indissoluble entre la qualité et la quantité d’éducation ?
I.1.2. Conséquences à tirer de cette formulation :
Trois conséquences au moins découlent du lien que l’ODD4 fait entre qualité et quantité de l’éducation :
Il n’y a pas d’exercice véritable du droit à l’éducation quand l’éducation n’est pas de qualité. Dit autrement, quand l’éducation perd en qualité, en d’autres termes quand elle cesse progressivement d’être éducation pour devenir déformation, il y a déjà, proportionnellement, violation du droit à l’éducation. Dans le langage commercial, on dit qu’il y a fraude, tromperie sur la marchandise et, en fonction de l’étendue de cette fraude, de cette tromperie, on peut parler, en langage juridique, de « dol ». Dans les termes du droit civil, le dol est une cause de nullité du contrat, un vice rédhibitoire. Le contrat de confiance qui lie la population à l’État en matière d’éducation – l’éducation est un devoir régalien de l’État – peut ainsi être rompu pour cause de défaut de qualité de l’éducation servie au peuple.
Il n’y a pas de qualité sans la quantité maximale : pour tous et tout au long de la vie. Chaque fois que l’éducation cesse d’être pour tous et tout au long de la vie, elle cesse, à proportion, d’être de qualité. Cela est vrai à la fois d’un point de vue économique (l’indice de Gini) et d’un point de vue social (les conséquences des discriminations à l’éducation en raison du sexe, du handicap, du statut social, des zones géographiques, de la religion, etc.).
L’ODD4 est donc extrêmement ambitieux et ne s’accommode d’aucune demi-mesure dans sa formulation. Sa mise en œuvre, dans notre contexte, ne peut ainsi être qu’un défi. Mais pour qui ?
1.2. Pour qui l’ODD4 est-il un défi ?
Nous avons parlé de l’éducation comme d’un contrat, d’une convention dont les parties sont, d’une part les populations (politiquement, elles constituent le « peuple »), d’autre part l’État, incarné par des gouvernants élus dans le système représentatif, sur la base de la confiance présumée que ces élus vont gérer les intérêts des représentés en bons pères de famille. L’ODD4 représente un défi pour chacun de ces deux acteurs, mais de façons différentes.
Pour les populations qui sont en position de bénéficiaires, le défi consiste à s’assurer le respect par l’État de son engagement de servir aux populations, à toutes les populations l’éducation de qualité à laquelle celles-ci ont droit. Pour l’État, le défi consiste à trouver les ressources adéquates et à les employer pour respecter son engagement à assurer aux populations une éducation de qualité (engagement pris en interne dans la Constitution, les lois d’orientation de l’éducation, à l’international à Jomtien 1990, Dakar 2000, dans le cadre des OMD et des ODD). Dans un contexte dit de sous-développement, ou peut-être en voie de développement, (toutes choses qui ne veulent pas dire grand-chose, sinon que nous sommes des pays à PIB faibles), en contexte donc de rareté de ressources, les principaux défis sont ceux de la qualité de la volonté politique et de la qualité de la gouvernance, puisque lesdites ressources, justement parce qu’elles sont rares, doivent être gérées de façon optimale.
Existe-t-il au Cameroun une volonté politique de qualité ? Les décisions prises (niveau stratégique), les actes posés (niveau opérationnel) dans le secteur de l’éducation ne l’attestent pas. Les derniers états généraux de l’éducation datent de 23 ans, les établissements scolaires fonctionnent presque sans enseignants et sans budgets de fonctionnement, la situation des enseignants fait de ce corps au Cameroun rappelle l’enfer de Dante au fronton duquel il était écrit : « Vous qui entrez ici, perdez tout espoir ». Aussi y règne-t-il un véritable sauve-qui-peut : il y a désormais au Cameroun plus d’enseignants hors du secteur de l’éducation que dans le secteur. Et tous émargent sur le budget de l’éducation, gonflant artificiellement celui-ci pour faire croire que l’éducation est financée, dans une espèce de prestidigitation assassine pour les intérêts de l’éducation, donc de l’avenir du pays. L’État bien sûr fait des choses dans l’éducation, la liste en est longue et fastidieuse : il faut que le budget se consomme. Mais ces choses se font hors de la qualité et de la quantité requises (c’est facile à démontrer mais ce n’était pas le sujet), et c’est ainsi que les retards accumulés dans la mise en œuvre de l’EPT se sont ajoutés à ceux des OMD et bientôt à ceux des ODD.
Que font ou peuvent faire les syndicats dans tout ceci ? Peut-on se demander. Pour bien comprendre en qualité et en quantité la contribution éventuelle des syndicats d’enseignants à la mise en œuvre d’une éducation de qualité pour tous tout au long de la vie, il faut d’abord examiner le positionnement des syndicats, historiquement au niveau global, puis contextuellement au Cameroun.
II. Les syndicats : des corps intermédiaires spécifiques
II.1. C’est quoi, les corps intermédiaires ? Intermédiaires entre qui et qui ?
Les corps intermédiaires, ce sont d’abord des Corps, c’est-à-dire des touts organisés et non des agrégats de circonstance. Nous disions plus haut qu’entre la population et l’État, il y a un contrat de confiance, mais la population (ou le peuple) n’est qu’un agrégat d’individus, de personnes physiques dont chacun se retrouve souvent bien seul face à l’État, et peut être physiquement violenté par ce dernier qui en a les moyens. Face ou au-dessus du citoyen, l’État est un corps –une personne morale) ou un ensemble de corps (on parle des grands corps de l’État). D’un côté, c’est cet agrégat d’individus impuissants, sans volonté qu’on appelle « société » et qui n’est qu’une collectivité dégradée.Pour Pierre Leroux,
« La société n’est plus qu’un « amas d’égoïsmes », ce n’est donc plus un corps ; ce sont les membres séparés d’un cadavre. »
Pour que les individus pèsent face au monstre étatique (le Léviathan), il faut qu’ils s’organisent en un corps ou en un ensemble de corps : ainsi émergent entre les individus et l’État des corps qui sont donc dits intermédiaires. Ils ne sont pas intermédiaires par leur seul positionnement, ils le sont également par la fonction d’interaction qu’ils exercent, pour citer Pierre Rosanvallon. Quels types d’organisations font ces corps intermédiaires ?
Les corps intermédiaires sont une nébuleuse aux contours variables. Pour Elisabeth Bergé-Suet (Lemonde.fr du 22.10.2015), ce sont les groupes professionnels, syndicats de salariés, organisations patronales, organisations agricoles, professions libérales, associations. Quant à Clotilde Druelle-Korn, maître de conférences en histoire contemporaine économique et sociale à l’université de Limoges (Lemonde.fr du 19.03.2012), elle veut distinguer plusieurs pôles dans la diversité que constituent les corps intermédiaires : le pôle des associations (associations d’intérêt économique, d’intérêt collectif comme les syndicats patronaux et de travailleurs ou d’utilité sociale), celui du monde consulaire (chambres de commerce et d’industrie, d’artisanat et des métiers, d’agriculture), et enfin celui des ordres professionnels (comices agricoles, conseils et commissions, fondations et organisations non gouvernementales). Quel est idéalement le rôle de ces corps intermédiaires ?
II.2. À quoi servent les corps intermédiaires ?
Le premier acte de la Révolution française fut de supprimer les corps intermédiaires, par la loi Le Chapelier de 1791. La Révolution déboucha logiquement sur le jacobinisme et sans surprise sur la terreur. Ayant pris soin de supprimer les corps intermédiaires, l’État révolutionnaire put écraser le peuple français sans rencontrer d’obstacles, de résistance. On dut ressusciter ceux-ci pour permettre au vaillant peuple français, qui avait pourtant fait la preuve de son courage dans la lutte révolutionnaire, de se remettre debout. C’était la preuve que, même courageux, le peuple ne peut rien contre l’État s’il n’est pas organisé en corps intermédiaires de qualité. Tout est cependant mis en œuvre par les pouvoirs établis pour les contenir, les affaiblir au maximum, les réduire dans certains contextes à de simples coquilles, ou alors des pierres de touche d’une démocratie formelle.
C’est que les corps intermédiaires, comme l’explique Clotilde Druelle-Korn, répondent à un puissant besoin social de s’unir pour agir d’une part, et sont un « réservoir d’expertise et des lieux d’action reposant massivement sur le bénévolat » d’autre part. Dans cette nébuleuse que constituent les corps intermédiaires, chaque type d’organisation, soit par ses origines, soit par ses modes d’organisation et d’action, occupe une place spéciale. Qu’est-ce qui fait la spécificité des syndicats dans l’univers des corps intermédiaires et comment et jusqu’où les syndicats camerounais mettent-ils cette spécificité au service des objectifs de l’ODD4 ?
II.3. La spécificité des syndicats parmi les corps intermédiaires
La première spécificité des syndicats parmi les corps intermédiaires, c’est qu’ils font peur, suscitent la méfiance pour le moins. Ils cristallisent en effet à eux seuls la plus grande part de la méfiance que les pouvoirs établis nourrissent à l’endroit de ces corps. En 2012 en France, lorsqu’il s’insurge contre ce qu’il appelle le « diktat » des corps intermédiaires, Nicolas Sarkozy pense dans une large mesure d’abord aux syndicats, et seulement dans une moindre mesure aux médias et autres structures intermédiaires. Les syndicats ne sont donc pas les seuls au sein du groupe des corps intermédiaires à lutter contre la toute-puissance souvent liberticide de l’État. Ce qui les distingue des autres, ce sont d’une part leurs origines, d’autre part leurs modes d’action et l’impact que ceux-ci sont susceptibles de produire.
Les syndicats sont comme on le sait issus des anciens compagnonnages et des corporations médiévales, structures nées pour concurrencer les hanses, organisations marchandes occupant à l’époque seules l’espace intermédiaire entre les noblesses (d’épée, de sang, de robes) et le tiers-état. L’on sait que ces organisations sont parmi les premières à avoir arraché des chartes de liberté au Moyen âge en Europe, et à avoir obtenu l’institution de villes franches où les individus, agriculteurs, éleveurs ou artisans, pouvaient jouir du fruit de leur travail à l’abri de la rapine des princes, des féodaux et consorts. Grâce à ces compagnonnages et corporations, les travailleurs avaient pu, pour la première fois (si l’on excepte dans une certaine mesure la Grèce de Solon) jouir des fruits de leur travail, lesquels n’avaient jusque-là profité qu’à l’aristocratie et aux seuls intermédiaires au service de celle-ci qu’étaient les marchands. Héritiers de la tradition des compagnonnages et corporations, les syndicats ont aussi hérité de l’antagonisme que ces derniers suscitaient auprès des hanses, et ce avec d’autant plus de violence que les marchands contrôlent la mondialisation actuelle. Derrière la haine des syndicats, il y a donc une volonté de continuer à marginaliser les travailleurs, pour perpétuer la monopolisation de la jouissance des richesses produites par le travail.
Les syndicats se distinguent aussi par leurs modes d’organisation et d’action, et l’impact que ceux-ci sont susceptibles de produire dans les conditions optimales. Au plan organisationnel, la structuration de ces organisations de travailleurs en syndicats, fédérations, unions, centrales, leur permet de déboucher sur des organisations hyper structurées et extrêmement fortes, aux moyens d’action éventuellement redoutables. On les soupçonne de ne pouvoir résister à la tentation, s’ils atteignaient leurs objectifs d’organisation et de mobilisation, d’en user pour mettre en œuvre une forme de corporatisme ou une autre. Du côté de leurs modes d’action, en plus du lobbying, du plaidoyer et d’autres types de manifestations publiques qu’ils partagent avec toutes les autres organisations faisant partie des corps intermédiaires, les syndicats sont les seuls à pouvoir user de l’arme de la grève : une arme qui peut être radicalement efficace si elle est bien utilisée. Il est ainsi peu surprenant que l’image du syndicalisme soit à peu près inséparable du spectre de la grève.
Pour autant, les syndicats ont presque tous abandonné le corporatisme étroit et ce depuis longtemps, pour s’engager dans la défense des intérêts généraux souvent idéalistes. L’histoire de l’éducation pour tous (EPT) devenue éducation de qualité pour tous (EQPT) et qui va de Jomtien 1990 jusqu’à Incheon 2015 s’est écrite avec les syndicats. Ces derniers n’y ont pas seulement accompagné les Gouvernements, ils les ont souvent précédés et poussés de l’avant. Lors de son congrès mondial 2015 à Ottawa, l’Internationale de l’Éducation a, par exemple, fait de l’Éducation en situation d’urgence (ESU) un axe prioritaire de son action, pour nous en tenir à une action récente.
Le procès de corporatisme qu’on continue de leur faire est donc bien peu mérité, bien peu justifié aujourd’hui. En plus, il est évident, même si les pouvoirs ouvertement autoritaires (Les démocraties ou ce qui en tient lieu aujourd’hui, notamment dans la forme libérale actuelle, peuvent sans excès être qualifiées de dictatures douces, ce qui nous rapproche de la philosophie politique d’Étienne de la Boétie) peinent souvent à l’admettre, que seuls les syndicats, quand les conditions sont réunies, sont à même d’organiser la revendication de matière non violente et contrôlée. Dans les pays où de telles conditions existent, les revendications syndicales, même quand elles se déportent dans les rues, n’ont jamais débouché sur le renversement de l’ordre politique établi. Par contre, partout où celles-ci n’existent pas, les revendications inorganisées et non encadrées ont souvent sonné le glas des pouvoirs en place.
Ce tableau global est-il conforme à la réalité syndicale nationale dans le secteur de l’éducation ?
II.4. L’action des syndicats d’enseignants au Cameroun en faveur de l’ODD4
Au Cameroun, sans doute plus qu’ailleurs, le statut des syndicats explique l’état de délabrement dans lequel se trouve le système éducatif, et les maigres résultats obtenus par l’État dans la mise en œuvre des politiques d’éducation de qualité pour tous.
De façon globale, les lois de 1990 sur les libertés ont consacré l’ensemble des corps intermédiaires (associations, médias, partis politiques, organisations religieuses…) à l’exception des syndicats, surtout ceux du secteur public qui sont seuls capables d’impacter les politiques d’éducation. En contraignant ces derniers à une inconfortable clandestinité, on les rendait suspects aux yeux d’éventuels adhérents, impuissants en face d’une administration formée à la répression, incapables de recevoir des concours financiers conséquents puisque ne pouvant réunir les conditions d’ouverture d’un compte bancaire, donc presque totalement impuissants. Cette stratégie, au fil des ans, a atteint ses objectifs et les syndicats d’enseignants camerounais sont aujourd’hui probablement parmi les plus inorganisés et les plus faibles d’Afrique.
Dans l’incapacité d’utiliser l’arme syndicale par excellence, la grève, ils ont dû se contenter, en dehors de quelques « grevettes » d’envergures relativement faibles, de faire du plaidoyer. Symboliquement, chaque fois qu’ils ont pu réunir les conditions d’une grève acceptable, ils ont obtenu en une action ce que des années de plaidoyer n’ont pu permettre à l’ensemble des corps intermédiaires de l’éducation d’obtenir. Ces apports syndicaux, si limités soient-ils, ont porté sur un aspect essentiel de la mise en œuvre de ce qui est aujourd’hui l’ODD : la qualité.
Nous avons vu plus haut que la qualité n’est pas négociable d’une part, et que la quantité est peu utile si elle n’atteint pas le seuil qualitatif, d’autre part. C’est aussi dans ce sens que l’on parle de la qualité des effectifs, des infrastructures et équipements, des financements : en quantité insuffisante ou excessive, ils desservent la qualité. Dans l’éducation, la qualité est garantie seulement par un facteur central : l’enseignant. Pas d’éducation de qualité sans enseignant de qualité. Pour les enseignants, les syndicats ont obtenu ces 20 dernières années un statut à peine appliqué, des primes auxquelles on a attribué des montants dérisoires, des distinctions honorifiques qui s’organisent dans le bricolage total, la promesse d’intégrer les cadres dont on n’est pas sûr, vu la lenteur d’exécution, qu’elle sera tenue.
Toujours au plan qualitatif, les syndicats ont obtenu de l’État l’engagement de ce dernier de revoir le cadre stratégique de l’éducation par la tenue d’un forum national, mais la mise en œuvre de cet engagement est reportée d’année en année.
Enfin, les syndicats sont les seuls à opposer à l’auto-satisfecit de l’État un discours véritablement critique et articulé sur des faits. Face à une expertise syndicale de plus en plus indéniable, l’État fait de plus en plus preuve d’humilité, mais en même temps affine ses techniques de manipulation de données.
Conclusion
Dans un contexte et des conditions difficiles, les syndicats camerounais se sont efforcés de contribuer à ce qui aurait dû être la mise en œuvre d’une éducation de qualité accessible à tous, d’abord dans le cadre de l’EPT, des OMD, et aujourd’hui des ODD en général, de l’ODD4 en particulier. Faut-il entrer dans le détail des actions qu’ils ont accomplies au long des années dans cette optique ? À quoi bon ? Ce serait fastidieux et peu utile. Ces actions n’ont pas permis jusqu’ici d’atteindre le niveau d’impact escompté : elles n’ont pas atteint la qualité et la quantité suffisantes pour changer sensiblement la donne. Aussi, comme les OMD et avant eux l’EPT, l’ODD4 va mal jusqu’ici. Tant que les syndicats ne seront pas redevenus forts, les corps intermédiaires seront majoritairement dociles, et les pouvoirs en place auront plaisir à en faire des pierres de touche d’une démocratie formelle. Et plutôt que d’exiger de l’État qu’il respecte ses engagements, la société civile, de plus en plus infiltrée, se contentera de le supplier de bien vouloir faire ce qu’il veut ; et le peu qu’il fera, sous les applaudissements volontaires ou contraints, sincères ou hypocrites, sera considéré comme l’expression d’une indicible magnanimité.