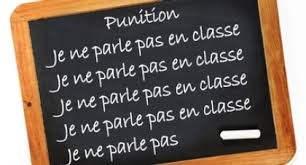DISCOURS DES SYNDICATS A L’OCCASION DE LA 24èmeJOURNEE MONDIALE DES ENSEIGNANT(E)S
Monsieur le Préfet du département de la Menoua,
Monsieur le Sous-préfet de l’arrondissement de Dschang,
Monsieur le Maire de la commune de Dschang,
Mesdames et Messieurs les Autorités politiques, religieuses et traditionnelles,
Messieurs les Délégués Départementaux chargés de l’encadrement des jeunes,
Camarade Secrétaires Généraux des syndicats ici représentés,
Mesdames et Messieurs les Chefs d’Etablissements,
Chers enseignant(e)s,
Camarades syndicalistes,
Chers invités,
Le 5 octobre, comme chaque année depuis 1994, la Journée mondiale des enseignants commémore l’anniversaire de la signature de la Recommandation OIT/UNESCO concernant la condition du personnel enseignant (1966) dont le 50ème anniversaire a été célébré l’an dernier, et la Recommandation de l’UNESCO concernant la condition du personnel enseignant de l’enseignement supérieur (1997) dont cette année marque le 20ème anniversaire. Ces deux recommandations définissent des normes internationales applicables à la profession enseignante et la Journée mondiale des enseignants est l’occasion de réfléchir aux moyens de s’attaquer aux défis qui subsistent dans leur mise en œuvre. Les gouvernements sont interpelés sur le respect de leurs engagements et les enseignants appelés à s’engager encore plus pour la promotion de la profession enseignante.
C’est donc pour célébrer l’édition 2017 de cet anniversaire, que j’ai l’honneur de prendre la parole devant vous, au nom de tous les syndicats d’enseignant représentés dans la Menoua, pour prêcher l’évangile de l’enseignant. Je voudrais aussi par la même occasion vous adresser notre salut syndical et vous exprimer notre profonde considération.
Mesdames et messieurs,
l’IE, l’OIT, l’UNESCO, l’UNICEF et le PNUD ont choisi pour thème cette année 2017 : « Enseigner en liberté, autonomiser les enseignants ». En effet, la liberté fait partie de l’essence de la profession enseignante et Vincent Peillon, alors ministre français de l’éducation nationale déclarait :
« Enseigner n’est pas un métier d’exécution. La liberté pédagogique est absolument essentielle pour les enseignants. ».
La recommandation de 1966 précise, dans la section VIII, paragraphe 61 que:
« Dans l’exercice de ses fonctions, le corps enseignant devrait jouir des franchises universitaires. Les enseignants étant particulièrement qualifiés pour juger des auxiliaires et des méthodes d’enseignement les mieux adaptés à leurs élèves, ce sont eux qui devraient jouer le rôle essentiel dans le choix et la mise au point du matériel d’enseignement, le choix des manuels et l’application des méthodes pédagogiques, dans le cadre des programmes approuvés et avec le concours des autorités scolaires. ».
La loi d’orientation de l’éducation au Cameroun enfonce le clou dans son article 38 en disposant que :
« L’enseignant jouit, dans le cadre des franchises académiques et dans l’exercice de ses fonctions, d’une entière liberté de pensée et d’expression, dans le strict respect de la liberté de conscience et d’opinion des élèves. »
Nous pouvons donc dire sans risque de nous tromper que l’enseignant enseigne la liberté. En cela, peut-il enseigner la liberté sans être libre ? Sans être un modèle de liberté ? Assurément non ! Ainsi, l’école, lieu par excellence de l’expression de cette liberté doit être préservée des incursions des forces politiques, religieuses, économiques… , éloignée de quelques formes de pressions que ce soit !
But freedom goes hand in hand with responsibility and this responsibility can only be fully assured if teachers are empowered and valued. Jean-Pierre CHEVENEMENT, former French Minister for Education,said:
« It can not be said enough that the future of a country depends on the quality of its teachers … a country that devalues its teachers is committing
suicide. »
Hence, putting teachers out of material constraints through fair remuneration and decent working conditions, raising them above the chains of dogmatism and extremism through quality initial and continuous intellectual, scientific and pedagogic training, appear as a vital necessity for human societies.
Malheureusement, un rapide tour d’horizon nous offre le triste spectacle d’une école camerounaise aux antipodes de la liberté. Nous vivons une époque sombre où notre école est en proie à la violence.
En effet, les enseignants camerounais portent le deuil. Deuil de l’assassinat brutal du Proviseur Charles ETOUNDI du Lycée Bilingue Sultan Ibrahim NJOYA de Foumban, tombé sur le champ de la tribalisation des nominations aux postes de responsabilité dans l’éducation. Nous voudrions ici lui rendre un vibrant hommage et condamner avec la dernière énergie cet acte barbare posé par des individus qui veulent porter atteinte au vivre
ensemble si cher au peuple camerounais. Nous crions aussi avec la même énergie haro sur ses responsables tapis dans les ministères et qui ont fait de l’origine ethnique le seul critère de nomination renvoyant aux calendes grecques la méritocratie et le profil de carrière.
Cette triste actualité n’est cependant que l’arbre qui cache la forêt des entraves de l’éducation au Cameroun. Il n’est pas excessif de le dire mais :
L’école camerounaise est prise en otage ces derniers mois par des politiciens qui l’utilisent comme monnaie d’échange pour assouvir leurs ambitions parfois questionnables ;
L’école camerounaise est prise en otage par l’indigence et la pénurie qui privent nos établissements d’infrastructures dignes de ce nom, qui transforment nos écoles en lieux exsangues où le maximum que l’on peut attendre est le paquet minimum, qui abandonnent nos établissements scolaires aux maîtres des parents et aux vacataires, esclaves des temps modernes ;
L’école camerounaise est prise en otage par une machine administrative et bureaucratique pléthorique et vorace qui pousse les jeunes enseignants à faire des sit-in pour être pris en solde, qui entretient le floue et transforme en comptoirs commercial la gestion des carrières ;
L’école camerounaise est prise en otage par les forces du marché qui ont fait main basse sur l’outil clef de l’éducation qu’est le manuel scolaire en lui assignant désormais comme seul objectif le lucre ;
L’école camerounaise est prise en otage par les fondateurs d’établissements privés laïcs et confessionnel qui freinent des quatre fers la signature de la convention collective de l’enseignement privé, jetant ainsi en pâture les enseignants du secteur privé en raison de contrats précaires, de bas salaires, et de protection sociale inexistante,
L’école camerounaise est prise en otage par la Présidence de la République qui est devenu le cimetière de tous les textes issus des négociations entre les syndicats d’enseignants et le Gouvernement (rééchelonnement indiciaire, intégration des enseignants d’EPS dans le statut particulier des fonctionnaires du corps de l’éducation nationale, revalorisation de la prime de documentation et de recherche)
Ladies and gentlemen,
Our country has the peculiarity to have an educational system which is divided in two subsystems each one having its own specificities. We think that this is a treasure that needs to be well exploited. For this to be profitable to us, these two subsystems need to offer equal chances of success to the cameroonian youth. This is the occasion for us to deplore the absence of a truely anglophone technical education which penalises the products of the anglophone subsystem in the entire country, by submitting them to a low-quality technical education. Added to this, this subsystem has recently faced the degradation of the teaching language quality due to teachers who were posted not because of their mastery of english language but because of other reasons best known to those who are in charge of
postings. How do we then understand that, in violation of article 15(2) of the orientation law of 1998, typically francophone diplomas continue to be awarded to candidates who went through the anglophone subsystem namely technical CAP, Probatoire, baccalaureat ?
IMG-20171006-WA0008IMG-20171006-WA0014
Définitivement, l’éducation au Cameroun est un grand malade sur lequel il faut d’urgence se pencher. La nécessité de la tenue effective du forum national de l’éducation promis depuis bientôt 5 ans se fait de plus en
plus sentir et il est temps de saisir cette opportunité historique qui s’offre à nous en exigeant la tenue de ce forum maintenant.
En attendant, nous profitons de cette occasion pour saluer à juste titre la grande avancée consentie récemment par les pouvoirs publics qui ont engagé le processus de l’intégration des professeurs contractuels de l’enseignement secondaires et de la première vague des IC. C’est une injustice longtemps décriée par les syndicats qui a ainsi commencé à être corrigée et nous souhaitons que ce processus soit rendu automatique pour les autres vagues des IC. Pour le reste, comme l’année dernière, les syndicats d’enseignant continuent d’exiger :
Que les textes achevés et transmis au Président de la République soient signés ;
Que le processus de mise en œuvre de la convention collective de l’enseignement privé soit mené à son terme ;
Que le forum sur l’éducation soit organisé pour remettre de l’ordre dans notre système éducatif.
Quant à nous enseignant, allons-nous continuer à attendre dans l’indolence et la torpeur que tous les obstacles soient levés sur notre chemin ? Allons-nous continué à avoir peur ? Jusqu’à quand allons continuer à faire montre de lâcheté ? Chers collègues, il n’y a aucune fierté dans le défaitisme et l’attentisme. Sachons-nous montrer dignes de mériter le respect et la considération que la société nous doit.
Mobilisons-nous pour défendre notre liberté !
Levons-nous pour défendre notre profession !
Mobilisons-nous pour sauver l’éducation !
Syndiquons-nous massivement !
Vive la Journée Mondiale des enseignants !
Vive le Cameroun !
Je vous remercie de votre aimable attention.
SYNTESPIC SNIEB SECA SNAES